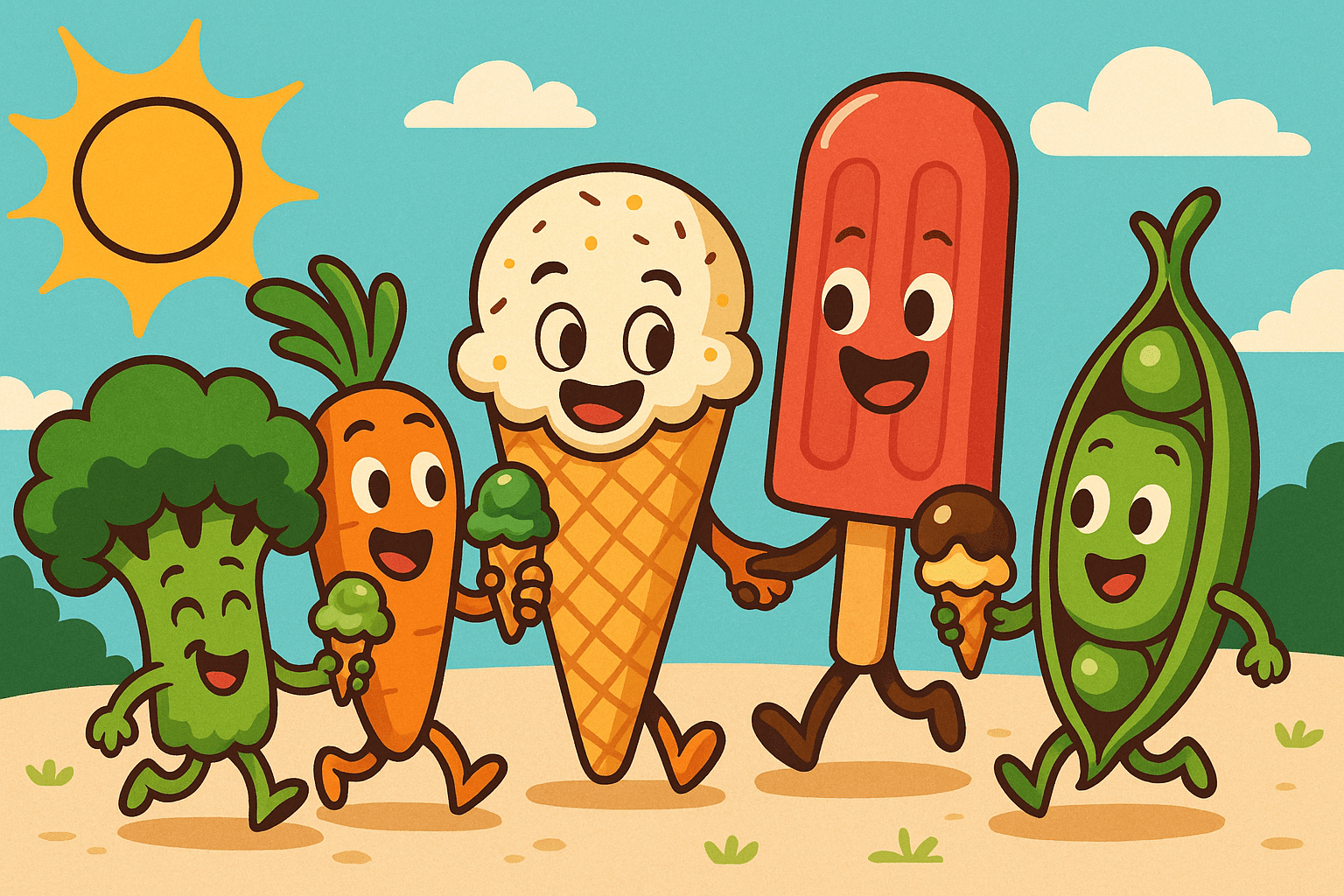
Comment nos goûts d’enfance influencent nos choix végés
Cela vous est-il déjà arrivé de refuser un plat simplement parce qu’il vous rappelait un mauvais souvenir d’enfance? Ou, au contraire, de devenir tout sourire à la seule évocation d’un dessert que vous adoriez petit? Nos goûts d’enfance sont souvent plus profonds qu’on ne le pense. Ils peuvent façonner toute une vie alimentaire et même décider de notre volonté de manger végétarien. En tant qu’adulte, on peut ressentir un certain décalage entre ce que l’on croit aimer et nos goûts d’origine. Mais comment notre enfance influence-t-elle concrètement nos préférences végétariennes?
L’influence précoce: une histoire de saveurs et de mémoire
Les goûts se développent dès le plus jeune âge. Dès la période fœtale, des études montrent que les saveurs ingérées par la mère peuvent être transmises au fœtus via le liquide amniotique. Par la suite, lors de l’allaitement, l’enfant découvre de nouvelles saveurs à travers le lait maternel. Cette exposition précoce va en partie déterminer les aliments que l’enfant acceptera plus tard, ou rejettera au moment de la diversification alimentaire.
Ensuite, pendant l’enfance, la palette de goûts se construit au fil des expériences. Chaque goûter, chaque repas familial ou sortie au restaurant laisse une empreinte dans notre mémoire. Les aliments consommés très souvent deviennent familiers et généralement mieux acceptés. Inversement, ceux rarement proposés ou associés à des sensations négatives (goût trop fort, texture désagréable, contexte d’obligation à manger) risquent d’être boudés plus tard. On comprend alors mieux pourquoi certains adultes ne peuvent pas voir un brocoli en peinture, tandis que d’autres en raffolent.
Du point de vue d’une personne souhaitant s’orienter vers une alimentation végétarienne, ces souvenirs ancrés peuvent être un atout ou un frein. Un enfant qui a grandi dans une famille cuisinant beaucoup de légumes considérera probablement plus naturellement le végétarisme comme une option viable, car son répertoire gustatif est déjà riche en saveurs végétales. En revanche, quelqu’un dont l’enfance fut rythmée par des plats majoritairement carnés pourrait avoir besoin de plus d’adaptation pour que les préparations végétales lui paraissent aussi appétissantes que sa madeleine de Proust à base de viande.
L’impact social et culturel
La cuisine n’est pas qu’une affaire de saveurs: c’est aussi un vecteur culturel et social. Enfant, on mange le plus souvent ce qui est préparé à la maison, selon les habitudes culinaires familiales. On apprend à apprécier certains plats typiques, parfois même avant d’en connaître la composition exacte. Les festivités de famille (Noël, anniversaires) sont également des moments-clés où se forgent des souvenirs gustatifs. Quand, de plus, la grand-mère, les oncles et tantes ou les cousins partagent une même passion pour la dinde rôtie ou le saumon fumé, il devient normal de percevoir ces aliments comme incontournables, voire essentiels.
Chez certains enfants, toutefois, une éducation plus ouverte peut permettre de développer un attrait pour des aliments variés: fruits, légumes, légumineuses, céréales complètes, etc. Lorsqu’on passe régulièrement du temps avec des proches qui cuisinent des alternatives végétariennes, on peut dès l’enfance concevoir l’idée que la viande n’est pas indispensable et que l’on peut pleinement se régaler autrement. Au contraire, dans d’autres environnements, l’absence de viande peut être considérée comme un manque ou être associée à une forme de déprivation. Le regard positif ou négatif porté par la famille et les amis sur le végétarisme compte beaucoup dans le développement de la curiosité envers ce mode d’alimentation.
Le rôle de la répétition: manger et remanger
Il existe un principe bien connu en psychologie de l’alimentation: la familiarité naît de la répétition. S’il est souvent nécessaire de proposer plusieurs fois le même aliment à un enfant pour qu’il s’y habitue, ce mécanisme fonctionne aussi chez l’adulte. Lorsqu’on parle de transition végétarienne, on rencontre parfois un blocage initial face à certains légumes ou recettes nouvelles. Les goûts d’enfance peuvent exercer une résistance au changement.
Pourtant, avec un peu de persévérance et une approche créative, on peut réapprivoiser ses papilles. Par exemple, si vous détestiez les choux de Bruxelles étant enfant, vous pouvez essayer de les cuisiner différemment pour en découvrir une autre facette sensorielle (rôtis au four avec un filet d’huile d’olive et des épices, en sauce, etc.). Après quelques essais, il est possible que votre cerveau finisse par associer ces aliments à des expériences positives, au point de faire basculer votre jugement initial.
Voici quelques conseils pour marier répétition et plaisir:
- Varier la préparation: cuire un légume à la vapeur, puis au four, ou en le mélangeant dans un gratin.
- Jouer avec les épices et les herbes aromatiques: cela transforme la perception gustative d’un plat.
- Mélanger un aliment qui vous semble neutre (ex: riz) avec un nouvel ingrédient (ex: tempeh) pour diminuer la sensation de nouveauté.
- Commencer par de petites portions: éviter la pression d’un bol entier d’un plat inconnu.
- Se fier à la saisonnalité: un légume de saison est en général plus savoureux, ce qui facilite la découverte.
Comprendre la mémoire sensorielle pour mieux évoluer
La mémoire sensorielle est composée de nos perceptions (olfactives, gustatives, tactiles et visuelles) passées qui laissent une trace en nous. Lorsqu’on revisite des plats d’enfance, on peut ressentir une nostalgie ou une réticence immédiate, sans toujours se rappeler pourquoi. Cette mémoire agit parfois de manière subconsciente. Par exemple, l’odeur d’un certain ragoût peut instantanément évoquer à une personne le souvenir de la cuisine familiale dominicale. En ressentant l’odeur d’un plat proche, on est transposé quelques années en arrière.
Passer à un régime végétarien peut alors traduire un besoin de se reconnecter à des souvenirs sensoriels de l’enfance qui valorisaient les produits frais, la cuisine familiale, ou une atmosphère de partage harmonieuse. A contrario, on peut ressentir le désir de renier un passé trop axé sur la viande et la “malbouffe”. Dans les deux cas, reconnaître le poids de ces mémoires sensorielles permet d’aborder sa démarche végé avec plus de douceur et de compréhension envers soi-même. Plutôt que de s’imposer une rupture radicale du jour au lendemain, il est souvent plus efficace d’effectuer une transition progressive, en privilégiant des recettes qui nous font du bien sur le plan émotionnel.
Les recettes réconfort: un pont entre hier et aujourd’hui
Pour adopter une alimentation végétarienne en accord avec nos goûts d’enfance, une bonne stratégie consiste à réinventer les plats traditionnels en version végé. Cela permet de rester attaché à ces souvenirs positifs, tout en restant cohérent avec ses convictions actuelles. Voici quelques idées, et l’on pourrait adapter à l’infini:
- Revisiter le hachis parmentier: Au lieu de la viande hachée, utiliser des lentilles (vertes ou brunes), des carottes et des oignons.
- Chili sans carne: Remplacer la viande par un mélange de haricots rouges, de poivrons et de tomates.
- Burgers végétariens: Utiliser un steak de pois chiches ou de haricots noirs et garnir avec les mêmes ingrédients qu’un burger traditionnel (tomates, oignons, laitue, fromage végétal ou non).
- Quiches et tartes: Opter pour un appareil à base de tofu soyeux ou de crème végétale aux herbes.
- Soupe comfort food: Un velouté de courge, de poireaux ou une soupe aux lentilles, façon grand-mère, peut apporter la même sensation réconfortante que les soupes de l’enfance.
Grâce à ces adaptations, on ne perd pas la chaleur des souvenirs. On peut au contraire raviver des émotions positives liées aux repas de famille, tout en se créant de nouvelles associations gustatives en harmonie avec notre mode de vie végétarien.
Les blocages courants et comment les surmonter
Malgré la volonté d’évoluer vers un régime végétarien, certains blocages subsistent. Parfois, c’est la peur de l’inconnu. Dans d’autres cas, c’est un fort attachement émotionnel à la viande, perçue comme un aliment-confort. Il n’est pas toujours évident de se détacher de notre enfance, surtout quand certains moments de joie ou de récompense tournaient autour d’un plat carné.
1. L’idée que “c’est moins bon” sans viande
Cette croyance vient souvent du fait que, dans l’enfance, la viande était perçue comme la pièce maîtresse du repas. Les légumes pouvaient faire office de simple accompagnement, parfois moins bien cuisinés ou moins valorisés. Pour dépasser ce sentiment, on peut explorer la cuisine végétarienne inventive, pleine de saveurs. Les restaurants spécialisés végé ou les blogs culinaires proposent souvent des assaisonnements originaux qui font vite oublier l’absence de viande.
2. La pression sociale ou familiale
On a parfois peur que notre famille désapprouve: “Tu ne manges plus mon rôti du dimanche? Tu n’aimes plus?” Il est possible de rassurer les proches en cuisinant pour eux des plats végétariens savoureux. Les convaincre par le goût est parfois la meilleure façon de prouver qu’on n’a rien perdu de la convivialité du repas en optant pour le végétarisme.
3. La nostalgie d’une époque révolue
Les souvenirs d’enfance sont souvent teintés de douceur. Changer d’alimentation peut donner l’impression de rompre avec ces moments précieux. On peut alors éviter la rupture frontale en revisitant ces plats, comme mentionné précédemment. Cette approche concilie nostalgiques de la courge farcie aux lardons avec une version tout aussi gourmande aux champignons.
L’importance de la variété dans l’éveil sensoriel
Les odeurs, les textures et les saveurs sont en perpétuelle évolution tout au long de la vie. Ce que nous aimions ou détestions enfant n’est pas nécessairement figé. Nos papilles grandissent, tout comme nous. En intégrant la variété, on barre la route à la routine et on continue à éduquer son palais. Cela peut être un vrai renouvellement, voire une découverte.
Au lieu de se contenter de 2 ou 3 plats végétariens fétiches, pourquoi ne pas explorer?
- Les plats du monde: cuisine indienne (dal de lentilles, currys), thaïe (pad thaï végétarien), mexicaine (enchiladas sans viande)
- Les sauces et condiments originaux: pesto de persil ou de roquette, sauce aux cacahuètes, sauce tamari sucrée-salée
- Les légumineuses variées: pois cassés, pois chiches, haricots azuki, lentilles corail
- Les simili-carnés: galettes de soja, seitan, tofu fermenté, tempeh
- Les légumes anciens: panais, topinambours, rutabagas, chou-rave
Chaque nouvelle recette met en lumière de nouvelles combinaisons de goûts. Avec un peu de curiosité, on sort du schéma habituel et on peut éventuellement se surprendre à aimer aujourd’hui ce que l’on refusait hier.
Le rôle des émotions
Nos choix alimentaires ne sont jamais entièrement rationnels. Les émotions jouent un rôle clé. Le réconfort, la punition, la récompense ou la convivialité associée à la nourriture dans l’enfance laissent une empreinte forte. Certains se consolent avec des sucreries, d’autres se sentent “forts” en mangeant de la viande rouge. Chacun a un rapport émotionnel différent. Toutefois, quand on envisage le végétarisme, réfléchir à ce que l’on recherche dans la nourriture peut aider à mieux comprendre ses motivations ou ses blocages.
- Cherche-t-on la sensation de satiété associée à la viande? Les protéines végétales rassasient tout autant.
- Éprouve-t-on de la culpabilité en mangeant de la viande? Cela peut renforcer la motivation à passer au végétarisme.
- Était-on hébergé chez des grands-parents qui forçaient à finir son assiette? Cela peut engendrer un rejet inconscient de certains aliments.
- Se souvient-on de moments chaleureux passés à cuisiner des gâteaux en famille? On peut reproduire ce lien affectif grâce à des recettes sucrées végétaliennes, par exemple.
En identifiant les émotions en jeu, on peut mieux faire la part des choses entre ce qui provient de notre passé et ce que l’on souhaite construire pour l’avenir.
Comment encourager les enfants dans cette voie?
Pour les parents adoptant un mode de vie végétarien, la question se pose souvent: “Comment donner envie à mes enfants de manger végé, sans les brusquer ni les forcer?” Les goûts d’enfance étant puissants, il est important d’offrir une expérience positive et variée.
1. Impliquer les enfants dans la cuisine
Les petits adorent mettre la main à la pâte. Couper (avec un couteau adapté), mélanger la pâte, choisir des épices… Tout cela les rend fiers et curieux. Ils sont plus enclins à goûter ce qu’ils ont préparé eux-mêmes.
2. Rendre les légumes ludiques
Créez des assiettes colorées et variées: des crudités en bâtonnets, un arc-en-ciel de poivrons, une pizza végétarienne en forme de visage souriant. L’aspect visuel suscite leur intérêt.
3. Ne pas diaboliser la viande
Si l’objectif est de leur faire adopter un régime majoritairement végétal, il peut être contre-productif de présenter la viande comme “le grand méchant”. Mieux vaut valoriser les bienfaits et la diversité des végétaux tout en expliquant clairement les raisons de votre choix (éthique, environnement, santé…).
4. Respecter leurs préférences
Chaque enfant a ses goûts. Forcer un aliment détesté peut créer un blocage durable. Il vaut mieux proposer régulièrement de petites quantités pour les familiariser, sans les y contraindre.
Concilier santé et plaisir
Les habitudes prises dès l’enfance peuvent avoir un impact sur la santé à long terme. Les légumes, fruits, légumineuses et céréales complètes sont reconnus pour leur richesse en nutriments et leur capacité à prévenir certaines maladies. En grandissant, si l’on a été habitué à savourer ces aliments, on dispose d’un bagage nutritionnel solide. Pour autant, la santé ne dépend pas uniquement de ce qu’on a mangé enfant. On peut toujours rééquilibrer ses apports à l’âge adulte en variant les sources de protéines végétales et les aliments complets. L’important est de trouver un juste milieu entre l’envie de manger sainement et la satisfaction de nos papilles.
En effet, passer fortuitement à un régime végétarien strict sans se renseigner sur la nutrition peut entraîner des carences (fer, vitamine B12, etc.). Il est donc essentiel de construire un plan alimentaire équilibré, surtout si l’on veut que l’expérience reste positive. Les goûts d’enfance peuvent nous attirer vers certains types de plats, mais apprendre à composer des assiettes riches et variées est un savoir-faire qui s’acquiert avec le temps et la curiosité.
Évoluer en restant connecté à ses souvenirs
Changer d’alimentation ne signifie pas renier ce qu’on a vécu. Reconnaître l’influence de notre enfance sur nos goûts permet de mieux comprendre notre relation à la nourriture. Et c’est précisément cette compréhension qui facilite l’évolution. Notre bagage familial et culturel peut être un tremplin vers l’exploration de nouvelles saveurs plus végétales, à condition de garder à l’esprit que nous avons tous la capacité de réécrire notre histoire gustative. Il n’est jamais trop tard pour apprivoiser une courgette ou un poivron, même si nous les avons boudés pendant 20 ans.
En faisant la paix avec nos souvenirs et nos préférences, on peut accueillir plus sereinement le changement. Le végétarisme n’est pas un cap de privation, mais bien un espace de découverte et de réinvention. Il nous invite à revisiter nos recettes traditionnelles, à dépasser nos préjugés et à tisser de nouveaux liens entre les aliments et nos émotions.
Conclusion
Nos goûts d’enfance exercent une forte influence sur nos choix alimentaires, y compris sur la décision de manger végétarien. Les repas familiaux, les traditions culturelles et la mémoire sensorielle façonnent nos préférences de façon parfois subtile. Au moment de franchir le pas vers une alimentation sans viande, ces souvenirs peuvent susciter de la nostalgie, de la résistance ou, au contraire, un élan pour retrouver des saveurs plus végétales déjà connues.
Heureusement, les goûts ne sont pas figés. Avec un peu de curiosité et de bienveillance envers soi-même (et envers ses proches), il est tout à fait possible de s’émanciper de certains blocages. Les légumes ou légumineuses autrefois détestés peuvent se réhabiliter grâce à de nouvelles techniques de préparation. Les plats traditionnels peuvent être revisités pour allier réconfort et éthique. Les émotions associées à la nourriture s’explorent et se transforment au fur et à mesure qu’on avance dans son cheminement personnel.
Finalement, comprendre l’origine de nos goûts nous permet de mieux nous adapter aux évolutions de notre mode de vie. Que l’on souhaite diminuer ou éliminer la viande de son alimentation, il existe autant de parcours que de raisons. Se réconcilier avec ses souvenirs d’enfance et exploiter ce bagage culinaire est une approche enrichissante qui peut rendre la transition plus naturelle et surtout plus savoureuse.
Même si nos papilles ont été façonnées dans une ambiance souvent carnée, un changement progressif et conscient, soutenu par la préparation de plats à la fois gourmands et mémorables, ouvre la porte à un autre rapport à l’alimentation: plus végétal, mais tout autant ancré dans l’émotionnel et le plaisir. À vous de jouer: pensez à ce que vous aimiez enfant et demandez-vous comment décliner ces délices en version végé dès maintenant. Bonne découverte!